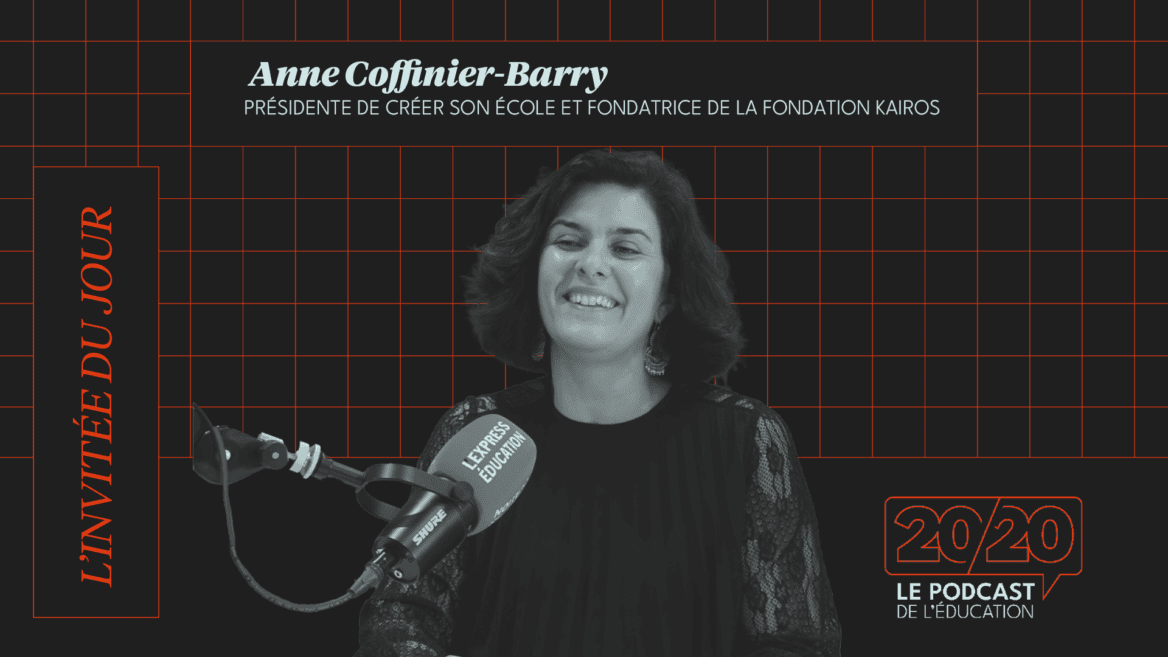Bienvenue dans 20 sur 20, le podcast de L’Express Education. Philippine Dolbeau, entrepreneure, conférencière et animatrice télé, y accueille des personnalités du monde de l’éducation, des hommes et des femmes inspirants venus livrer leurs réflexions sur l’école d’aujourd’hui et de demain. Alors, qu’ils soient chercheurs, entrepreneurs de la EdTech, professeurs, parents, politiques ou même philosophes, tous partagent la même volonté de transformer l’éducation et de préparer la nouvelle génération aux défis de demain. Chaque semaine dans 20 sur 20, nous découvrons ces acteurs qui font bouger les lignes de l’éducation.
Dans ce second épisode, Philippine Dolbeau rencontre Anne Coffinier, ancienne diplomate et dirigeante associative française. En 2004, elle fonde l’association Créer son école et soutient, depuis, le développement de plus de 800 écoles hors contrat. Quatre ans plus tard, elle crée la Fondation pour l’école, reconnue d’utilité publique. Fervente défenseur de la liberté scolaire, elle prône la liberté de fonder des écoles, relevant d’une vision éducative et pédagogique un peu différente de celle de l’Éducation nationale. Elle prend aussi régulièrement la parole sur le fonctionnement, ou parfois les dysfonctionnements, de notre système scolaire qui saura se réinventer par l’innovation, qu’elle soit technologique ou pédagogique. Dans ce cadre, la Fondation Kairos pour l’innovation éducative, qu’elle crée en 2020, sera son porte-voix. Interview.
Récemment interviewée par le média Omerta, vous avez affirmé que l’école ne cesse de s’enfoncer, et ce, depuis plus de 25 ans. Pourquoi ?
Anne Coffinier : Il faut savoir que j’ai reçu beaucoup de critiques de personnes qui me disaient : « 25 ans ? Mais pas du tout. C’est depuis 35 ans, 40 ans que ça va mal. » Effectivement, ça ne va pas bien depuis un certain temps. Le problème est structurel et cumulatif, puisqu’on a toute une génération de professeurs qui ne sont pas, aujourd’hui, aussi bien formés que ce qu’ils devraient être. On le voit notamment au niveau du CAPES : les professeurs sont recrutés parfois à 5 ou 6 de moyenne. On a donc cette situation d’un corps professoral qui a perdu en qualité.
La faute à la réformite aigüe dont est atteinte l’Éducation nationale ?
Anne Coffinier : Il y a beaucoup de raisons différentes. Je pense que le problème numéro un est qu’en France on a voulu faire de l’école le lieu d’une transformation politique du corps social. C’est-à-dire qu’on a surinvesti politiquement l’école. Ce n’est pas le cas de tous les pays qui voient en l’école un moyen de former des êtres autonomes, bien dans leurs baskets, qui ont envie d’agir, d’entreprendre et de prendre des risques. C’est par exemple le cas du modèle danois. Ce n’est pas la perspective française pour qui l’éducation est un outil politique, d’abord pensé par la gauche (et la droite essaie toujours d’annuler les effets que la gauche a sur l’école).
Vincent Peillon a écrit un livre, La révolution française n’est pas terminée, dans lequel il explique que l’école est le lieu qui doit achever la Révolution française. Cette idée que cette institution aurait pour but d’accomplir l’égalité des chances est un thème qui est apparu vers 2006-2007. Avant, on parlait quand même de justice sociale, c’est vrai, mais ce n’était pas l’objectif numéro un de l’éducation. Aujourd’hui, on a voulu que l’école soit le lieu qui assure l’égalité des chances. Or, cette égalité se définit de plus en plus vaguement : est-ce qu’on parle d’égalité des résultats ? Des moyens ? Est-ce qu’on veut égaliser la condition sociale à travers l’école ? Il y a clairement eu une dérive égalitariste qui n’est pas du tout dans la version d’origine de l’École républicaine, qui était très méritocratique.
La méritocratie implique quand même une forme d’élitisme : on prend tout le monde, on leur donne des bases et on essaye de repérer les pépites pour les faire monter et régénérer les élites. C’est là l’idée de la méritocratie. Mais, ce qui prévaut aujourd’hui, ce n’est pas une approche méritocratique, mais plutôt une approche égalitariste, qui n’aime pas beaucoup la différenciation des êtres. On parle beaucoup de “groupe classe” et de cette idée qu’il faut que tout le “groupe classe” fonctionne. On ne prend pas tellement l’élève comme une individualité, et lorsqu’il y en a une qui se détache, elle pose plus de problèmes qu’autre chose.
C’est un modèle très différent de celui des anglo-saxons ou des danois ?
Anne Coffinier : En Grande-Bretagne, on cherche à faire des leaders. J’ai vécu en Écosse pendant cinq ans et c’était amusant de constater que j’étais presque une caricature de française. Je voulais savoir si mes enfants s’en sortaient bien en mathématiques. Or, au début, les enseignants étaient catastrophés parce que mon fils aîné était timide. Cela leur paraissait vraiment très grave. Quand il a fini par bien intégré à la “communauté éducative”, là, ils y ont vu un succès. Il n’y avait toujours pas moyen de savoir s’il était bon en mathématiques ou pas. Parce que, pour eux, ce qui était fondamental c’était d’être populaire, bien intégré et ensuite d’avoir un point de force, une passion, et d’être capable de le transformer en excellence.
On cultive davantage la différence à l’étranger, contrairement à la France où l’on a tendance à stigmatiser ?
Anne Coffinier : Je pense qu’à l’étranger on est surtout moins scolaire et qu’on cultive l’idée de la formation du caractère, qui est une chose qui s’est perdue en France. Par exemple, une des figures phares de l’École des Roches, André Charlier, dans ses lettres aux capitaines, expliquait comment il cherchait à faire des leaders : des gens capables de résoudre des tensions, d’emmener les gens à se dépasser, etc. Il créait donc ce système de capitaineries, directement inspiré du système anglo-saxon. Il nommait capitaine des jeunes qui, parfois, n’étaient pas bien solides. Mais le fait de porter ce titre les tirait vers le haut et leur donnait le goût d’une certaine forme d’exemplarité. Il arrivait donc à mener vers l’excellence des jeunes qui avaient des qualités, mais qui n’étaient peut-être pas très réguliers, ni très solides, ni très exemplaires. Cette idée de faire éclore des talents, cette ingénierie humaine, ce n’est pas quelque chose qu’on a en France.
Le sujet n’est-il pas également qu’en France, on est spécialiste dans l’art de faire des lois qui ne sont pas forcément pensées dans l’intérêt de l’épanouissement ? Est-ce que cette réformite aiguë dessert les élèves français ?
Anne Coffinier : Il est certain que le système institutionnel scolaire n’est pas si stable. La première chose à faire est d’arrêter de le transformer tout le temps : les programmes, les diplômes, les organisations en général. Cela a peu d’intérêt et je crois que cela cache plutôt une sorte de résignation à la médiocrité. Il y a quelques grandes simplifications à faire, quelques grandes libertés à rendre, mais il faut avant tout éviter cette bougeotte permanente. Michel Blancaire, là-dessus, avait eu raison : on est obligé de faire confiance aux professeurs. […]
On fait beaucoup de réformes, mais y en-a-t-il encore trop peu pour l’orientation de nos jeunes ?
Anne Coffinier : Sur l’orientation, on est très nuls. La première raison à cela est d’ordre culturel : les enseignants ont une culture publique. Ils ont une forme de méfiance à l’égard du secteur privé. Ils ont aussi des idées assez arrêtées. Beaucoup de jeunes, par exemple, issus de l’immigration, sont orientés vers l’enseignement professionnel, quasi mécaniquement et inversement, lorsque vous avez un enfant qui choisit un métier manuel et que vous êtes un bourgeois, les gens ne comprennent pas non plus. Moi, j’ai une fille qui est pâtissière. Je peux vous dire que ça pique dans mon entourage. Parce que les gens ne comprennent pas. En France, on est très attaché au diplôme. Donc, même si on n’en fait rien, il faut des diplômes. Il vaut mieux faire une licence de sociologie que d’apprendre un métier de manière précoce. Ce n’est pas bien vu.
Il est plus difficile de s’orienter aujourd’hui qu’il y a 25 ans ?
Anne Coffinier : Oui, je pense que c’est plus difficile parce qu’il y a une multiplication des métiers. On a l’impression qu’il y a des passerelles dans tout, mais en même temps, c’est devenu très technique. Il y a aussi une internationalisation qui n’existait pas du tout il y a 25 ans. On rencontre également de nombreux doubles, triples cursus qui ne sont pas loin d’être de l’arnaque. J’ai pas mal de jeunes qui bossent avec moi, ils sont à Normal Sup, et il suffit qu’ils fassent une petite bricole pour être diplômés d’HEC, de l’ESSEC ou de Sciences-Po. C’est devenu illisible pour les recruteurs, qui ont intérêt à être malins pour parvenir à savoir s’il y a une vraie formation d’orientation derrière ou s’il y a juste un petit coup de tampon. Je trouve donc, qu’en apparence, tout est possible, mais tout est aussi très brouillé. Vous pouvez aujourd’hui être diplômé d’HEC avec finalement une idée assez vague de la manière de monter une entreprise ou de rendre une activité rentable. […]
Pour quelles raisons, selon vous, la France est toujours parmi les derniers des classements internationaux, comme PISA ?
Anne Coffinier : Je crois que la première raison est qu’on ne cultive pas assez l’engagement et la confiance des jeunes. Cela engendre l’idée qu’il ne faut surtout pas faire quelque chose de faux. Par exemple, vous avez beaucoup de jeunes qui préfèrent ne pas répondre à une question plutôt que de tenter leur chance et de risquer de se tromper. On a peur de l’erreur en France. Or, dans ce type de test (QCM et autres), forcément, cela ne peut pas fonctionner. Ensuite, je crois que tout simplement, on dilue beaucoup trop les apprentissages. Pour ce qui est des apprentissages purs et durs, c’est-à-dire lire un texte, le comprendre, le transformer en quelque chose qui fait sens et être capable d’utiliser les informations pour en faire quelque chose, ce n’est pas du tout acquis.
Est-ce que ces tests devraient guider l’action politique ?
Anne Coffinier : Ce qui est certain, c’est qu’on n’a pas encore tiré les conséquences. On est en moyenne 26, 28 ou 29e sur 81, en maths, sciences et lecture. Dans ces trois matières, on est donc soit dans la moyenne, soit légèrement au-dessus ou légèrement en-dessous. C’est minable pour un État comme la France et ce qu’il investit, surtout, on n’arrête pas de descendre. Sur ce test, on voit aussi que, malgré nos grands discours sur la lutte contre la discrimination et en faveur d’une école qui égalise les chances, le système français est celui dans lequel les inégalités de départ prédisent le plus les inégalités de résultat. Le classement PISA l’a démontré en premier et ensuite, on l’a vu tout le temps. C’est-à-dire que l’école est tellement mal faite que c’est la famille qui fait la différence. C’est aussi simple que cela. […]
Est-ce que pour vous, les diplômes servent encore à quelque chose ? Est-ce qu’ils ont encore une valeur ?
Anne Coffinier : Je pense que les diplômes sont utiles, mais qu’il ne faut pas hésiter à les reprendre et à les repenser. Pour le bac, on a deux ou trois options différentes qui s’offrent à nous. Première option, le supprimer. C’est radical et ça fait faire de belles économies, dont on a besoin. Globalement, le bac tel qu’il est aujourd’hui ne sert à rien. Donc on peut supprimer le Bac et faire du contrôle continu pur : si un élève a moins de 10 de moyenne, il n’a pas le bac.
Deuxième solution, on revient à un bac avec des épreuves qui peuvent être en première ou en terminale, comme on veut. Et là, on remonte une véritable exigence. Il faut donc partir du principe qu’on peut arriver à 60-70% de bacheliers. Il faut que ce Bac soit intéressant, qu’il fasse peur. Il faut qu’on se dise qu’il faut travailler pour l’obtenir et qu’il se mérite. C’est cela qui redonnera également de la légitimité aux professeurs. Parce qu’aujourd’hui, si vous voulez, c’est plus intéressant de terroriser un professeur pour qu’il vous mette des bonnes notes au contrôle continu, plutôt que de l’écouter, puisque ce n’est pas tellement les quatre épreuves finales qui comptent, mais celles du contrôle continu. On peut faire peur au prof, on peut tricher, et puis on peut tricher ensuite en trafiquant sur Internet ses notes. C’est une stratégie qui existe aujourd’hui.
Et puis, la dernière solution, c’est effectivement de faire un bac à l’allemande, c’est-à-dire un bac exigeant. En fonction des résultats au bac, on voit dans quelle fac on peut entrer. C’est-à-dire que le bac sert à quelque chose. Il ne faut pas oublier que le bac est le premier grade universitaire. C’est ce qui autorise à commencer des études. Or, aujourd’hui, ce n’est pas le cas. Le bac n’a aucun rapport avec la capacité à faire des études. Et d’ailleurs, le taux d’échec dans les études est colossal. […]
Est-ce que vous saluez le fait que les stages en entreprise soient maintenant obligatoires ?
Anne Coffinier : Il était temps, mais il faudrait surtout des stages pour les professeurs. Il faut relier le monde de l’entreprise et celui de l’éducation, que ce soit pour les élèves comme pour les enseignants. Pour autant, je pense qu’il faut revenir à l’idée que l’école n’est pas là pour faire de la chair à pâté économique. Elle n’est pas là pour faire des gentils producteurs, des gentils agents économiques performants pour faire gagner de l’argent aux gens qui les emploieront. L’école, elle est là pour faire des êtres capables de penser par eux-mêmes, des citoyens, des hommes et des femmes libres. C’est ça son objectif. On ne doit pas en démordre. Mais il se trouve que des êtres qui ont l’habitude de réfléchir, d’avoir une certaine exigence éthique, ce sont aussi des gens qui sont capables de créer de la valeur ajoutée, d’être des collaborateurs intéressants. Mais l’objectif numéro un ne doit pas être de faire des gens qui vont plaire aux entreprises. L’objectif numéro un est d’aider des jeunes à devenir pleinement hommes et femmes. C’est déjà très compliqué.
À LIRE AUSSI
– Devenir enseignant : pourquoi passer l’agrégation ?
– Devenir prof, toujours une vocation ?
– Universités et grandes écoles : une dualité française à bout de souffle ?
Alors ensuite, pourquoi ça ne va pas dans l’entreprise ? Mais souvent pour des choses toutes bêtes. Il y a des évidences qui se sont complètement évanouies. Le fait d’être à l’heure, le fait de s’habiller, d’avoir une tenue appropriée, le fait de ne pas faire uniquement des choses que vous trouvez vous-même justifiées, mais aussi des choses qu’on vous demande. Il y a aussi, globalement, une tendance de l’enfant-roi qui s’est diffusée. On a l’impression que tout leur est dû. Alors que quand vous êtes stagiaire, objectivement, vous n’apportez pas grand-chose, vous embêtez plus qu’autre chose. Donc, c’est clairement une opportunité qu’on donne à ces jeunes. Il ne faut pas inverser la vapeur. Mais ça, ça ne leur traverse pas l’esprit. Donc, je pense qu’il y a des choses toutes simples à remettre en place et c’est le rôle de l’école, qui doit redevenir exigeante. C’est le meilleur service qu’elle puisse rendre à l’économie. […]
De plus en plus de jeunes ne vont pas vers le CDI mais veulent monter leur boite, par désir de liberté et par volonté d’avoir un impact. Qu’est-ce qui pousserait aujourd’hui un jeune à se dire : « Je veux avoir de l’impact dans l’éducation ».
Anne Coffinier : C’est un mouvement de fond. Les jeunes veulent du sens. Et qu’est-ce qui a plus de sens que de créer une structure qui transmet le sens ? Il y a donc beaucoup de jeunes qui veulent faire quelque chose autour de l’éducation. Créer une école c’est quelque chose qui leur plaît et un projet dans lequel ils ont envie de s’investir. Je trouve cela très encourageant.
Personnellement, je trouve normal que les jeunes n’aient plus spécialement envie de prendre des CDI. Je ne vois pas le problème. Parce que là aussi, on est victime d’une vision très normée. Je me souviens, il y a quelques années, on admirait l’ascension sociale d’une famille dont le grand-père était paysan, le fils instituteur, et le petit-fils normalien ou énarque. Vous avez donc, à l’origine, quelqu’un qui est peut-être pauvre, mais qui est libre d’initiatives et qui fait un peu ce qu’il veut sur ses terres. De l’autre côté, vous avez des gens qui, finalement, sont des personnes qui obéissent dans un cadre très contraint. Est-ce vraiment une ascension sociale ? Pas pour moi. Pour moi, l’ascension sociale, c’est quand vous gagnez en champ de liberté et en impact. Si ce n’est pas le cas, vous régressez, même si vous gagnez plus.
Selon vous, à quoi ressemblera l’école de demain ?
Anne Coffinier : Pour moi, elle ne ressemblera absolument pas à l’école d’aujourd’hui. Ça sera une école en continuum éducatif. Il y aura des moments collectifs, des temps individuels, beaucoup de choses à distance et beaucoup plus de stages. On va revenir à ce qui existait avant le XIXᵉ siècle, c’est-à-dire une plus grande imbrication entre les jeunes et les adultes, entre la sphère productive et la sphère d’apprentissage. Je pense que finalement, c’était une parenthèse qu’on a connue sur le XVIIIᵉ, XIXᵉ, XXᵉ siècle et que l’on va revenir à quelque chose qui ressemble plus à ce qui existait avant, où le jeune était rapidement plongé dans le monde des adultes et appelé à devenir un adulte à sa manière. Il y a une capacité des jeunes qui est sous-utilisée en France en termes de responsabilités et de fiabilité. En fait, un enfant est capable d’assumer beaucoup plus qu’on ne le pense. Donc, on les maintient dans une sorte de tutelle et de minorité qui, en fait, ne les aide pas à grandir.
Si demain, je vous donnais les clés du ministère de l’enseignement supérieur, quelle serait votre première mesure ?
Anne Coffinier : La première mesure de toutes, c’est de supprimer le monopole de la collation des grades de l’État. C’est-à-dire qu’aujourd’hui, tout un secteur d’initiatives reste bloqué par le fait qu’on ne peut pas émettre des diplômes. Je renouvellerais complètement cette question de la manière d’émettre des titres. Il y aurait alors de nouveaux critères, pour reconnaître un diplôme, mais ce ne serait plus cette idée que c’est à l’Éducation nationale de le faire ou non. Parce que le monopole de la collation des grades, il remonte à Napoléon. C’était un contexte qui était tout à fait différent, très centralisé. Or, les choses ont un peu changé depuis.
On ne vous a jamais proposé un poste de ministre de l’Éducation ?
Anne Coffinier : Eh bien si, mais je ne dirais pas qui, ni quand, ni où. Si vous voulez, c’est un poste qui est très explosif. La machine de l’Éducation nationale est très rétive à la direction des ministres successifs. Vous avez des ministres qui connaissaient très bien leur machine et qui ne sont pas arrivés à faire ce qu’ils voulaient. Michel Blancaire, par exemple, connaît très bien la machine, mais il n’est pas arrivé à faire ce qu’il voulait du tout. Donc en fait, c’est compliqué et pour pouvoir vraiment faire bouger la machine, il y a plusieurs conditions. Il faut le soutien absolu de l’Élysée, la capacités à accepter un certain nombre de réformes qui vont mettre des gens dans la rue, avec un certain nombre de vagues. Donc c’est quand même des conditions qui sont particulières. Si on n’est pas prêt à cela, ce n’est pas à peine d’y aller.
La France est un pays mystérieux en ce sens qu’il ne sait pas faire des réformes, il sait faire des révolutions. Et c’est avec cette réalité mystérieuse qu’il faut quand même arriver à trouver une issue la moins houleuse possible. Je ne sais pas si on va y arriver. Et là, dans les deux années qui arrivent, je ne suis pas sûre qu’on soit très bons pour arriver à faire des réformes sans houle. Et je crois qu’il faut préparer l’avenir. De ce point de vue-là, il faut qu’il y ait tout une série de gens qui ont l’habitude de travailler ensemble. Il faut travailler sérieusement, longuement et surtout impliquer la société civile, impliquer le secteur privé. Ce n’est pas une affaire de fonctionnaire, c’est une affaire de collectif, de citoyens, d’universitaires, d’intellectuels et de chefs d’entreprise. Il n’y a pas plus politique et plus collectif qu’une réforme éducative et faire que tous ces gens-là, et la société tout entière, croient en l’école !