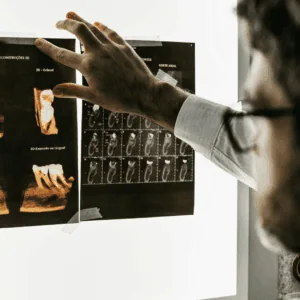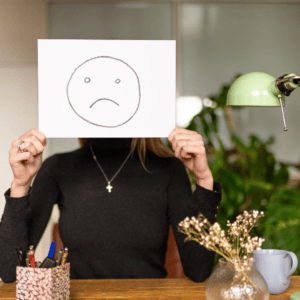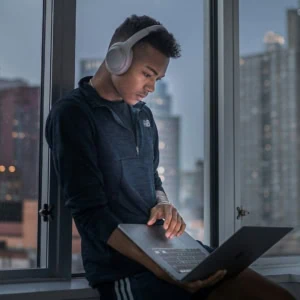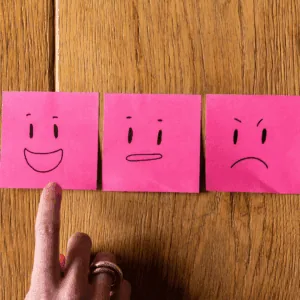L’Intelligence artificielle (IA) s’impose dans de plus en plus de secteurs d’activité. En ingénierie, tous les domaines sont impactés par ces avancées technologiques. Aujourd’hui, les ingénieurs doivent « absolument » les maîtriser, assure Véronique Favier, directrice adjointe de l’École nationale supérieure d’Arts et Métiers (ENSAM).
De nombreux métiers sont impactés par l’utilisation de l’intelligence artificielle (IA). Certains secteurs sont particulièrement concernés, comme celui de l’ingénierie. De fait, peut-on encore, aujourd’hui, être ingénieur sans avoir de connaissances sur l’IA ? Pour Véronique Favier, directrice adjointe de l’École nationale supérieure d’Arts et Métiers (ENSAM), la réponse est claire : « Il faut absolument que les ingénieurs maîtrisent l’intelligence artificielle ».
« Elle va faciliter les tâches, accélérer le travail, apporter de nouvelles solutions. L’IA va permettre aux ingénieurs d’être plus efficaces, plus compétitifs », assure-t-elle. Pas d’inquiétude cependant sur la nécessité d’une présence humaine, affirme la directrice adjointe. « Il faut absolument s’approprier ces outils-là, mais aussi conserver l’expertise des ingénieurs, garder un esprit critique. Cela me semble essentiel face aux limites de l’IA ».
« Tous les domaines de l’ingénierie vont être transformés par l’IA »
Concrètement, de quels changements s’agit-il ? « Tous les domaines d’ingénierie vont être transformés par l’IA, selon Véronique Favier, évoquant le rapport du Think Tank Arts et Métiers sur la manière dont l’IA générative va révolutionner les métiers d’ingénierie. Le génie civil, électronique, informatique, ou encore le génie des télécommunications, le génie industriel 4.0, le génie des matériaux, le génie biomédical… ».
La professeure évoque notamment « le procédé de fabrication additive » en ingénierie des matériaux. « C’est un procédé très souple et capable de produire des pièces de forme complexes, impossible à fabriquer par les procédés conventionnels. On rentre le dessin numérique d’une pièce, puis, par une technique d’impression 3D, on crée la pièce sans avoir besoin de faire des moules, décrit-t-elle. Mais il y a de nouveaux aspects à prendre en compte, comme des parois très fines ou des refroidissements très forts. Cela change les matériaux élaborés ». C’est là qu’intervient l’IA. « Elle nous aide en analysant des micrographies en faisant de la reconnaissance d’images exactement comme une caméra peut reconnaître un chat, un chien, etc. L’IA détecte rapidement les défauts des matériaux élaborés ce qui prenait énormément de temps auparavant ».
Autre exemple, dans le domaine du génie biomédical cette fois : la création de prothèses. « Faire une prothèse qui reproduit la mobilité humaine est une tâche particulièrement complexe. Notamment lorsque l’amputation est au-dessus du genou. Il faut arriver à coordonner le mouvement du genou et le mouvement de la cheville. Descendre un escalier, monter dans une voiture… Cela reste quand même très compliqué. Des solutions robotisées ont été mises en place, mais elles sont lourdes, avec une faible autonomie, etc. », détaille Véronique Favier. Pour les améliorer, les chercheurs de l’Institut de Biomécanique Humaine Georges Charpak, situé sur le campus parisien d’Art et Métiers, et l’entreprise PROTEOR, ont mis au point des prothèses dotée d’IA. « Ils ont collecté une multitude de données correspondant à différents terrains, différents scénarios. Grâce à ça, la prothèse est capable d’ajuster son comportement à l’environnement dans lequel elle se trouve, en temps réel. La mobilité est bien meilleure ».
L’IA peut également aider les ingénieurs dans ce qu’on appelle « les jumeaux numériques ». « Le rôle d’un jumeau numérique est de représenter le mieux possible le comportement d’un système réel, le jumeau physique. L’IA va alimenter rapidement le jumeau numérique en données qui viennent du système réel. De fait, elle va améliorer la performance et la précision du jumeau numérique. L’ingénieur, lui, va pouvoir le tester dans plusieurs situations différentes et évaluer les risques, sans avoir à les tester en réel. Cela s’applique à la conception d’une nouvelle voiture par exemple ».
L’IA permet aussi à l’ingénieur, entre autres, « de prendre des décisions en temps réel, indique la directrice adjointe d’Arts et Métiers. Si vous avez un équipement en fonctionnement, l’IA va capter les signaux, par exemple, de température et de vibration. Si elle détecte des dérives en temps réel, elle va alerter le responsable de la maintenance, qui va pouvoir programmer l’opération de maintenance de l’équipement. Au lieu de le faire tous les six mois, ce qui ne correspond pas forcément à la santé de l’équipement, il va le faire au moment où on en a besoin. Cela va réduire les opérations de maintenance, et, de fait, les coûts qui y sont associés ».
« Les ingénieurs ne doivent pas être des experts en intelligence artificielle »
Pour autant, « les ingénieurs ne doivent pas être des experts en IA », estime Véronique Favier. « Ils ne vont pas développer des algorithmes, ils vont les utiliser. Mais il faut savoir les utiliser à bon escient, en connaître les limites et les risques », prévient-elle. Aujourd’hui, l’utilisation de l’IA est autorisée au sein de l’école, « en donnant un cadre d’utilisation, en insistant sur un usage éthique et responsable. Les étudiants peuvent se servir de l’IA générative pour de l’assistance à des travaux de rédaction, de traduction, de programmation ou de conception ».
Par ailleurs, Arts et Métiers a mis en place un appel à manifestation d’Intérêt « Compétences et Métiers d’Avenir » (AMI CMA) sur l’IA. « Il s’agit du projet CAIRE, avec l’objectif de créer du contenu de modules de formation sur l’IA sur trois niveaux : les fondamentaux, la maîtrise, et l’expertise », explique la directrice adjointe.
Les étudiants de première année recevront dès la rentrée prochaine un enseignement commun de niveau 1 dédié à l’IA. « Ensuite, l’enseignement de l’IA se fait au travers de celui, plus classique, d’un ingénieur, soit, dans notre école, en génie mécanique, génie industriel et génie énergétique. Ce deuxième niveau, le niveau maîtrise, va dépendre des métiers, explique Véronique Favier, précisant que « les enseignants-chercheurs de l’école, par leur activité de recherche, se sont déjà appropriés des outils d’IA ».
« Dans le cadre du niveau 3, expertise, on formera peut-être quelques ingénieurs en dernière année afin qu’ils soient un peu plus experts en développement de l’IA. Mais nous visons prioritairement le niveau maîtrise », assure-t-elle, avant d’affirmer : « Dans l’enseignement supérieur, il est désormais impensable ne pas former nos futurs ingénieurs à l’IA ».
Notre résumé en 5 points clés par L’Express Connect IA
(vérifié par notre rédaction)
Voici un résumé en cinq points clés de l’article sur le sujet : La maîtrise de l’IA est-elle devenue indispensable pour les ingénieurs ?
Importance croissante de l’IA en ingénierie : L’intelligence artificielle (IA) est devenue essentielle dans tous les secteurs de l’ingénierie. Véronique Favier, directrice adjointe de l’ENSAM, souligne que les ingénieurs doivent absolument maîtriser ces outils pour améliorer l’efficacité et la compétitivité, garantissant ainsi la pérennité de leurs projets.
Impacts sur la formation : Il est crucial pour les établissements d’enseignement supérieur, comme l’ENSAM, d’intégrer des modules sur l’IA dans leurs programmes. Les étudiants recevront des formations adaptées, réparties sur trois niveaux : base, maîtrise, et expertise, garantissant ainsi une préparation adéquate aux défis futurs.
Applications concrètes de l’IA : L’IA transforme divers aspects de l’ingénierie, de la fabrication additive à la création de prothèses intelligentes qui s’ajustent en temps réel aux besoins du patient. Des outils comme les jumeaux numériques permettent une meilleure modélisation des systèmes, facilitant l’évaluation des performances.
Rôle complémentaire plutôt qu’expert : Les ingénieurs n’ont pas besoin d’être des experts en IA, mais ils doivent savoir utiliser ces technologies efficacement et en connaissance de leurs limites. L’ENSAM implémente une utilisation éthique de l’IA, tout en préparant les futurs ingénieurs à intégrer ces solutions dans leurs pratiques professionnelles.
Responsabilité sociétale : Les technologies basées sur l’IA doivent être utilisées de manière responsable. Les dirigeants d’entreprises et les éducateurs insistent sur l’importance d’une formation qui respecte des principes éthiques, car l’intégration de l’IA dans l’ingénierie ne doit pas se faire sans une réflexion sur l’impact social et environnemental.