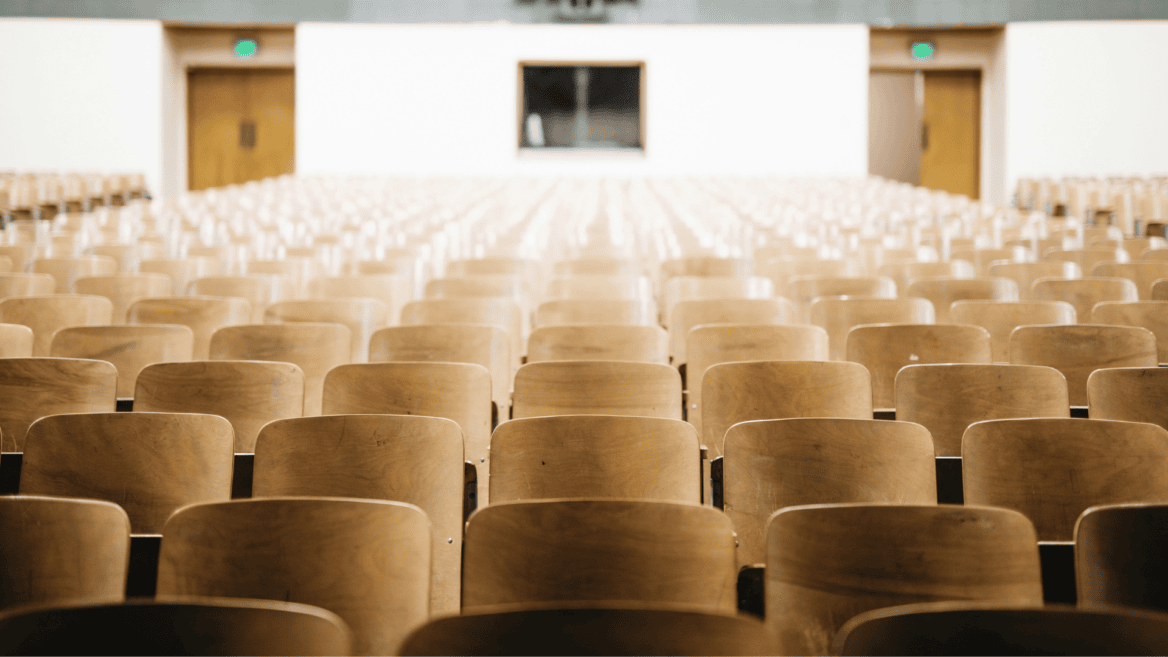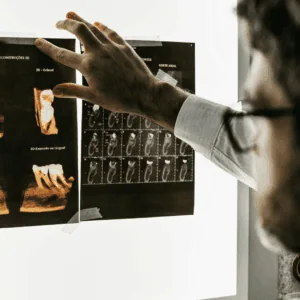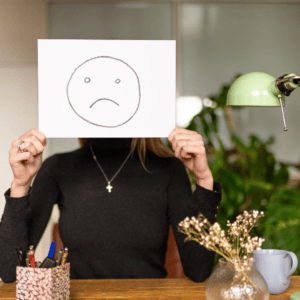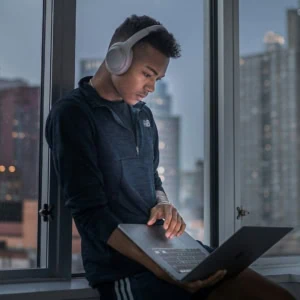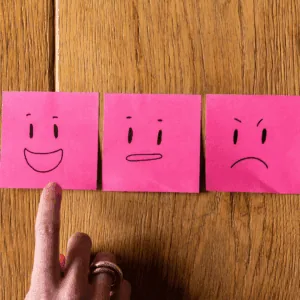Héritée du XVIIIe siècle, la séparation entre universités et grandes écoles constitue une singularité française. Longtemps perçue comme une richesse, cette dualité apparaît de plus en plus comme un frein alors que l’interdisciplinarité, l’excellence scientifique et la lisibilité internationale deviennent des impératifs d’innovation.
Pour François Germinet, ancien président de l’université de Cergy et ex-responsable du pôle connaissances du SGPI, il est temps de dépasser cette opposition pour réinventer un système cohérent, inclusif et compétitif.
Un modèle bicéphale hérité de l’histoire
La séparation entre universités et grandes écoles remonte à l’Ancien Régime et à l’industrialisation. « Ce clivage est né d’une commande de l’État pour développer les techniques, construire les routes et les ponts, maîtriser la machine à vapeur. Les écoles formaient les ingénieurs, les universités produisaient les thèses académiques. À l’époque, cela fonctionnait très bien », retrace François Germinet. Mais ce modèle, forgé pour répondre aux besoins du XIXe siècle, semble aujourd’hui dépassé.
Dans les disciplines scientifiques, cette séparation produit des effets pervers. « On ne met pas les élèves les plus curieux en face des meilleurs chercheurs », déplore François Germinet. « Un chercheur de haut niveau postule à l’université ; un étudiant brillant veut intégrer l’école d’ingénieurs. Résultat : on ne croise pas les publics. C’est absurde. »
Des effets pervers sur la recherche et l’innovation
Ce cloisonnement a un impact direct sur la capacité du pays à former ses futurs cerveaux. « Les écoles, dans leur grande majorité, ne font pas de recherche, ou très peu. Et très peu de leurs diplômés poursuivent en doctorat — autour de 10 %. » Or, pour François Germinet, la recherche doctorale est la clef de voûte de toute stratégie technologique. « La recherche d’aujourd’hui, c’est la technologie de demain, donc le business de demain. Si on forme trop peu de docteurs, on hypothèque notre avenir. »
Un constat d’autant plus inquiétant que le doctorat est culturellement dévalorisé en France. « Un ingénieur sera mieux payé qu’un docteur. Pire, dans l’entreprise, on se demande encore pourquoi quelqu’un ferait une thèse. C’est l’inverse de l’Allemagne, des États-Unis ou de la Chine. Chez nous, même à l’ENA, on sort sans thèse. On a des gens brillants qui dirigent le pays sans jamais avoir fait l’expérience intellectuelle de la recherche, s’être frottés à l’ouverture d’esprit et la plasticité du cerveau que représente ce travail. »
Des rapprochements réels… mais encore trop timides
Le rapprochement entre universités et grandes écoles, bien que progressif, est accompagné par l’État. Les programmes IdEx (Initiatives d’Excellence) et I-SITE (Initiatives Science – Innovation – Territoires – Économie), lancés en 2010 dans le cadre des investissements d’avenir, ont pour volonté de créer de grands pôles de formation et de recherche capables de rivaliser avec les meilleures institutions internationales.
Paris-Saclay, PSL, Strasbourg, Bordeaux ou encore l’Université de Lille ont, via ces dispositifs, intégré ou fédéré des écoles d’ingénieurs, des instituts de recherche et des partenaires socio-économiques. On observe depuis leur montée en puissance notable dans les classements internationaux, notamment en mathématiques ou en ingénierie.
À Paris-Saclay, CentraleSupélec, AgroParisTech et l’ENS Paris-Saclay évoluent désormais au sein d’un ensemble cohérent, structuré autour du doctorat et de la recherche. Cette politique publique, aujourd’hui prolongée et amplifiée par le plan France 2030, marque une volonté nette de faire converger des cultures académiques longtemps séparées. Des établissements comme l’Université Gustave Eiffel — née de la fusion d’une université, d’un organisme de recherche et de trois écoles d’ingénieurs — ou CY Cergy Paris Université, en partenariat avec l’ESSEC, en incarnent les formes les plus abouties.
Pour François Germinet, ces rapprochements doivent désormais passer à une échelle plus large. « Il ne suffit pas d’empiler les structures. Il faut un projet commun, une lisibilité académique et une culture de la recherche partagée. C’est à cette condition qu’on pourra redonner du sens au mot “université” en France. »
L’hybridation, nouvelle frontière de l’enseignement supérieur
Au cœur de cette mutation, un mot revient : hybridation. Sciences dures et sciences humaines, ingénierie et design, droit et économie : les formations qui décloisonnent les disciplines attirent de plus en plus d’étudiants et permettent de toucher des publics plus diversifiés.
« À Cergy, la filière ingénieur-informaticien comptait 85 % de garçons. Dans la même filière avec un module design intégré, on passait à 60 % de filles. Les cours étaient pourtant identiques en maths et en info. C’est l’intitulé, la projection sociale, qui changeait tout. » Pour François Germinet, il est urgent de ne plus penser la technique en dehors de son écosystème : « Concevoir un aéroport, ce n’est pas juste une affaire d’ingénierie. Il faut penser l’usage, l’ergonomie, les impacts environnementaux et sociaux. »
Cette logique inspire des programmes d’excellence comme les doubles cursus ingénieur–Sciences Po, ou les parcours architecte–ingénieur. Autant de formations qui « préparent à créer, pas seulement à reproduire », insiste François Germinet.
Des signaux faibles à transformer en dynamique de fond
Les synergies existent : programmes conjoints, bachelors hybrides, laboratoires interdisciplinaires. Les taux de pression dans ces formations parlent d’eux-mêmes. Mais ces initiatives restent encore trop isolées. « Il faut envoyer un signal plus fort, institutionnaliser ces approches, leur donner de la visibilité. »
Même les classes préparatoires commencent à évoluer. À Henri-IV, le programme CPES développé avec PSL incarne cette ouverture : une prépa qui s’insère dans un cursus universitaire intégré, sélectif mais lisible, pensé pour les standards internationaux.
Pour François Germinet, le temps de la réforme structurelle est venu. « On a hérité d’un système efficace pour son temps. Mais ce temps est révolu. Le monde a changé. Il nous faut un enseignement supérieur qui parle un langage commun, qui valorise la recherche, qui rassemble au lieu de séparer. »
Notre résumé en 5 points clés par L’Express Connect IA
(vérifié par notre rédaction)
Voici un résumé en cinq points clés de l’article sur le sujet : Universités et grandes écoles, une dualité française à bout de souffle ?
Une séparation historique dépassée : La distinction entre universités et grandes écoles, qui remonte au XVIIIe siècle, est désormais perçue comme un frein à l’innovation, empêchant l’interdisciplinarité et la coopération nécessaires dans un monde en évolution rapide.
Manque d’interaction entre les deux systèmes : Cette dualité nuit à la formation des futurs chercheurs en limitant le croisement entre étudiants et chercheurs, ce qui impacte négativement l’innovation et la recherche doctorale, essentielle pour le développement technologique.
Rapprochements timides mais nécessaires : Bien que des initiatives comme IdEx et I-SITE favorisent l’intégration de divers établissements d’enseignement supérieur, il est crucial d’élargir ces efforts pour créer un projet pédagogique cohérent et partager une culture de la recherche.
L’hybridation comme solution : L’avenir de l’enseignement supérieur passe par l’hybridation des disciplines. Des programmes combinant ingénierie, sciences humaines et design attirent des étudiants diversifiés et préparent à des carrières innovantes, en prenant en compte les enjeux sociétaux.
Urgence de réforme : François Germinet appelle à une réforme structurelle pour créer un système d’enseignement supérieur qui favorise la collaboration, valorise la recherche et s’adapte aux besoins contemporains, consolidant ainsi la position de la France sur la scène internationale.