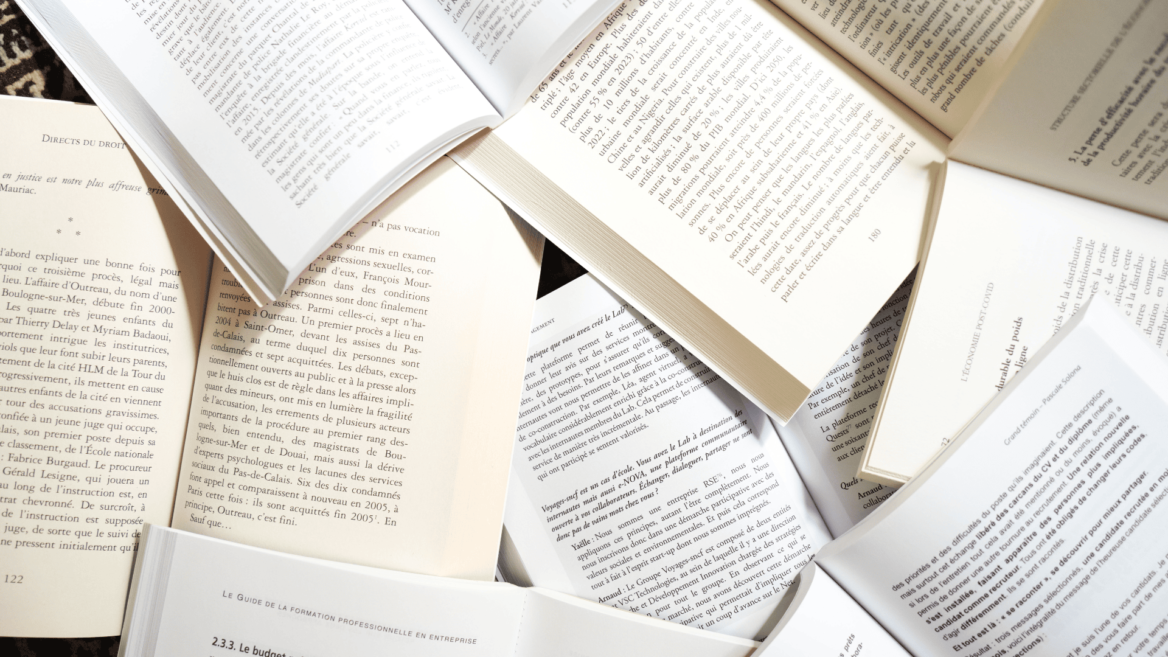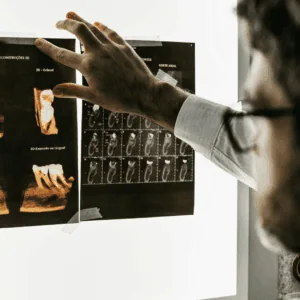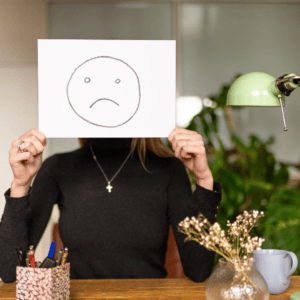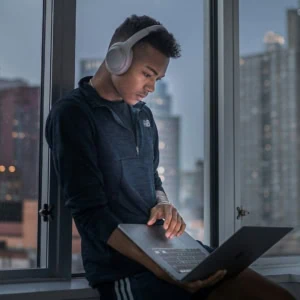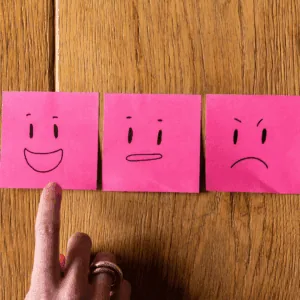L’hypokhâgne, ou première année de classe préparatoire littéraire, tire son nom de la « khâgne », sa grande sœur de deuxième année. Cette formation pluridisciplinaire s’inscrit aux côtés des prépas scientifiques et économiques dans le prestigieux triptyque des grandes écoles françaises.
Accessible après le baccalauréat et dispensée en lycée, elle offre aux étudiants une équivalence universitaire de 60 crédits ECTS, correspondant à une première année de licence. Découvrez-en plus sur les conditions d’admission, les concours préparés, les débouchés professionnels ainsi que les opportunités de poursuite d’études après une hypokhâgne.
Quel est le programme de la prépa hypokhâgne ?
L’hypokhâgne est la première année des classes préparatoires littéraires en France. Elle se décline en deux parcours distincts :
- la filière hypokhâgne A/L (lettres classiques).
- la fillière hypokhâgne B/L (lettres et sciences sociales).
En première année d’hypokhâgne en filière A/L, les élèves suivent le programme axé sur les matières littéraires, avec des cours de littérature française, de géographie, d’histoire, de langues étrangères, philosophie, une langue ancienne (latin ou grec), ainsi que la culture de l’antiquité. Selon les établissements, les étudiants peuvent également choisir une option artistique, telle que l’histoire de l’art, le cinéma, les arts plastiques, la musique ou le théâtre. Parfois, des cours d’Éducation physique et sportive (EPS) sont proposés.
La première année d’hypokhâgne en filière B/L marie quant à elle lettres et sciences. Les élèves y étudient le français, les mathématiques, les sciences économiques et sociales, l’histoire, la philosophie et deux langues vivantes. Le volume horaire privilégie les mathématiques et les SES, sans négliger les autres matières. Une spécialité complémentaire s’impose parmi le latin, la géographie, le grec ancien ou la civilisation de la LV1.
L’emploi du temps d’une hypokhâgne avoisine les trente heures de cours par semaine, rythmées par des interrogations orales régulières dans chaque discipline. L’objectif de cette formation est de préparer les étudiants à passer en deuxième année de Khâgne, puis intégrer les grandes écoles.
Quels concours sont préparés par la CPGE Littéraire – filière A/L ?
Au terme de deux années de préparation, la Banque d’Épreuves Littéraires (BEL), pilotée par les écoles normales supérieurs, ouvre la voie vers des parcours d’excellence. L’ENS de Lyon, aux côtés des ENS Paris-Saclay et PSL, sélectionne rigoureusement ses futurs normaliens, destinés principalement à l’enseignement et à la recherche. Mais les horizons ne se limitent pas aux ENS. De nombreuses grandes écoles s’appuient sur les écrits de la BEL pour leur recrutement, parfois en y ajoutant leurs propres épreuves. Les écoles de commerce, via les concours BCE et Ecricome, accueillent depuis plus de deux décennies les talents littéraires.
D’autres institutions, comme l’ISIT (management interculturel), l’École des Chartes (pour ceux ayant suivi une option spécifique), le CELSA (communication et médias), l’ISMaPP (management public), ou encore l’Esit (traduction), sont aussi accessibles. Les IEP d’Aix-en-Provence, de Lille et de Lyon font partie de ces opportunités. De plus, des concours spécifiques permettent aux IEP de Saint-Germain-en-Laye et de Bordeaux de recruter des candidats issus des prépas littéraires.
Comment intégrer une classe préparatoire hypokhâgne ?
L’entrée en première année de prépa littéraire hypokhâgne nécessite la constitution d’un dossier de candidature, comprenant :
- une lettre de motivation
- les relevés de notes du lycée
- un CV
La procédure se fait via la plateforme Parcoursup, qui centralise les demandes de recrutement. À l’échelle nationale, les prépas littéraires sont considérées comme un unique vœu, tandis que chaque établissement correspond à un sous-vœu distinct.
Comment entrer en hypokhâgne ? Les critères en 2025
Pour maximiser ses chances d’intégrer une première année de prépa littéraire, il est préférable de disposer d’un bon niveau scolaire. Les attentes pour intégrer une hypokhâgne en lettres classiques (A/L) sont les suivantes :
- Une bonne maîtrise de l’expression écrite et orale,
- Des compétences organisationnelles et une capacité à structurer des argumentations solides, tout en produisant un travail approfondi,
- Un intérêt marqué et un niveau de connaissances solides dans les disciplines des humanités.
Quant à la prépa hypokhâgne lettres et sciences humaines (B/L), les attentes se concentrent davantage sur :
- Une bonne organisation et des capacités de réflexion,
- Un intérêt marqué et un bon niveau dans les sciences économiques et sociales, les mathématiques ainsi que les humanités.
Quel niveau d’études est requis pour entrer en hypokhâgne ?
La classe d’hypokhâgne est ouverte aux bacheliers généraux. En effet, presque tous les candidats sont titulaires d’un baccalauréat général. À titre d’exemple, ils représentaient 98% des inscrits en hypokhâgne à la rentrée 2023, selon le ministère de l’Enseignement supérieur.
Quels débouchés s’offrent après hypokhâgne ?
La première année de prépa littéraire mène naturellement à la khâgne (deuxième année de prépa), qui se concentre sur la préparation à divers concours, tels que ceux des écoles de traduction, des écoles de communication, des écoles de commerce, des Écoles normales supérieures et de l’École du Louvre.
Une autre possibilité s’offre aux étudiants : intégrer une licence universitaire, à condition que celle-ci soit en lien avec les matières étudiées en hypokhâgne. Dans ce cas, il est nécessaire de s’inscrire parallèlement à l’université après l’admission en hypokhâgne. Par exemple, un étudiant ayant suivi une première année en lettres classiques pourra se tourner vers une licence en histoire, philosophie ou lettres. Quant à un étudiant venant d’une hypokhâgne B/L, il pourra choisir une licence en sociologie, mathématiques ou dans d’autres domaines des sciences sociales.
Quels métiers peut-on exercer après une hypokhâgne ?
Une hypokhâgne, en elle-même, correspond à un niveau BAC+1. En fonction de la suite des études, que ce soit en licence, en prépa, jusqu’aux concours ou en master, de nombreuses carrières s’offrent aux diplômés. Parmi elles, on trouve des secteurs variés tels que l’enseignement et la recherche, la communication, le commerce, l’ingénierie en statistiques, le journalisme, la médiation culturelle, ainsi que les domaines de la traduction et de l’interprétariat.